
Chronique de Palestine : Sophie Djigo, pouvez-vous en quelques lignes vous présenter ?
Sophie Djigo : Je suis philosophe et j’enseigne la philosophie au lycée Baudelaire de Roubaix. Je mène mes recherches au laboratoire Savoirs, texte et Langage à Villeneuve d’Ascq.
Mes recherches portent en premier lieu sur des questions éthiques, mais aussi sociales et politiques avec ce nouveau livre.
CP : Quelle est l’histoire du livre “Les Migrants de Calais” ? Du moment où l’idée vous en est venue jusqu’au moment de sa parution ?
S. Djigo : J’ai enseigné à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais pendant sept ans. Chaque matin, je prenais la ligne de TER Lille-Calais pour aller au lycée et depuis 2014, je voyais de plus en de migrants à bord des trains. Au bout d’un moment, on a commencé à discuter, à évoquer leurs conditions de vie. Puis, je me suis dit qu’il fallait recueillir cette parole, mais je ne voulais pas faire un livre de « témoignages ». C’est une perspective que je récuse, parce qu’elle place les migrants dans une posture passive, celle du sujet procédant par introspection pour raconter son vécu, explorer ses émotions et exprimer sa subjectivité. Ce n’était pas cela qui m’intéressait, mais plutôt de collecter leur expertise. Je voulais partir de leur propre analyse de la situation pour comprendre ces « jungles », l’existence de et dans ces campements.
En outre, comme tout le monde, je lisais la presse et j’étais abreuvée par les articles de La voix du Nord ou autres, qui au lieu de produire un éclairage sur la situation à Calais et dans la région, faisaient naître de plus en plus de perplexités. J’étais pressée de questions que je ne parvenais pas à résoudre : pourquoi appeler ces lieux des « jungles » ? Malgré les quelques rixes, largement mises en spectacle par certains médias, par quel miracle ces centaines, voire ces milliers de personnes, qui ne se connaissent ni d’Adam ni d’Eve, qui ne parlent pas la même langue, n’ont pas la même culture, réussissent-ils à vivre ensemble dans ces lieux dont les conditions de vie sont extrêmes ? Comment cela se fait-il que « ça tienne » et qu’il n’y ait pas plus de tensions et de violences ? Comment l’Etat français accepte-t-il et crée-t-il ces enclaves, qui sont de véritables no man’s land légaux, juridiques et sociaux, sur le territoire de la République ?
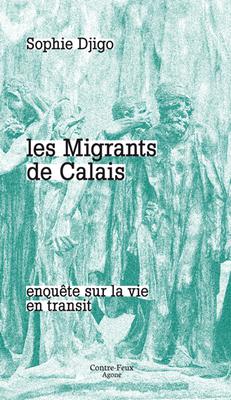
ISBN : 9782748902990
Format papier : 216 pages – 16.00 €
Editions Agone
Il fallait nouer des contacts, tisser des liens pour que la conversation en vienne à un certain niveau d’analyse et avec une centaine d’entretiens menés entre octobre et mars 2016, j’ai eu le matériau nécessaire pour faire le livre. Je tiens beaucoup à la méthode de l’enquête en philosophie, celle qui a été théorisée par toute une tradition philosophique très riche, comme le pragmatisme américain (de grands penseurs comme John Dewey).
Enquêter, c’est partir d’une situation obscure, indéterminée, source de perplexité. L’expérience du réel, qui nécessite de s’adapter à ce que l’on veut tenter de comprendre, d’accueillir ce qui advient, vise à produire une clarification à la fois des faits et de la manière dont nous en parlons, dont nous les représentons.
J’ai écrit mes précédents livres dans une durée plus « universitaire », en prenant mon temps. Au contraire, j’ai écrit ce livre-ci dans une réelle urgence, habitée par la nécessité d’écrire et de publier. J’ai totalement assumé la part d’inachèvement du livre, rajoutant quelques notes de bas de page au fil de l’actualité jusqu’à quelques heures avant que le manuscrit ne parte aux presses. Il y a des sujets sur lesquels la philosophie ne peut s’écrire sub specie aeternitatis ; qui exigent une écriture non systématique, l’expression d’une réflexion provisoire sur l’actualité et non l’élaboration d’une doctrine figée dans le marbre.
Entre le début de ce travail et sa publication, les « jungles » ont progressivement été démantelées et les « migrants de Calais » dispersés, à nouveau invisibilisés. Est-ce que cela signifie que le livre est (déjà) périmé ? Malheureusement, je ne crois pas et je pense que ce travail nous permet de mieux comprendre les ressorts de cette politique d’invisibilisation qui n’a rien d’original ni de nouveau, et pourquoi elle est vouée à l’échec.
CP : En quoi le qualificatif de “migrants”, pour toutes les personnes regroupées dans les camps sauvages autour de la région de Calais, est-il selon vous plus adapté que celui de “réfugiés” ?
S. Djigo : Le problème vient justement du fait que ces personnes ne sont pas des réfugiés. « Réfugié », c’est un statut juridique : cela signifie que vous avez fait une demande d’asile auprès de l’OFPRA et qu’elle a été acceptée. Toute la difficulté, c’est que ces migrants ne souhaitent pas demander l’asile en France, puisqu’ils veulent rejoindre l’Angleterre. Or, la République française ne prévoit rien pour ces personnes ; elles sont réduites à commettre, du simple fait de leur présence sur le territoire national, un délit administratif, celui du séjour irrégulier. Être sans statut, c’est être privé de tous ses droits, de la protection du droit, y compris des droits de l’homme. Être humain, ce n’est pas un statut ; et on voit bien que pour revendiquer ne serait-ce que les « droits de l’homme », il faut au préalable être reconnu en tant que sujet de droit, donc on en revient toujours à la question du statut. Il faut rentrer dans une catégorie administrative ou juridique pour exister dans l’espace public et dans celui du droit ; faute de quoi, vous êtes littéralement sans protection, dans une grande vulnérabilité.
Face à des migrants sans défense, certains policiers et certains civils se livrent à de très grandes violences, parce qu’ils ont le sentiment de pouvoir le faire en toute impunité. Et effectivement, comment ces individus clandestins, sans identité, qui vont jusqu’à limer leurs empreintes digitales, pourraient se saisir de l’instrument juridique contre la force publique (ses abus) ou contre les violences de civils qui sont, eux, des citoyens nationaux ?
CP : Vous mettez en évidence, dans votre livre, que le traitement infligé aux migrants révèle une absence de recouvrement entre “la loi” et “le territoire”. Pouvez revenir sur cette idée, si lourde d’implications ?
S. Djigo : La République s’est constituée à travers la double forme de l’Etat de droit et de l’Etat-nation. Cela suppose que les droits de chaque individu soient garantis sur le territoire national. D’où la tension entre les citoyens, forcément des nationaux, dont l’Etat protège les droits, et les résidents étrangers, qui se retrouvent sur cet espace national sans pouvoir bénéficier des mêmes droits. Dans le cas des migrants clandestins, la situation est encore plus complexe : en adoptant une politique d’immigration clandestine zéro et une politique peu généreuse en matière d’asile, l’Etat français transforme ces migrants en clandestins ; et en ne prévoyant aucune politique publique d’accueil, l’Etat crée lui-même des enclaves d’illégalité où vivent, au moins provisoirement, ces migrants illégaux.
Cela signifie que la loi n’est pas la même pour tous sur le territoire français, il y a ce que l’on pourrait nommer des frontières juridiques et légales à même l’espace de la nation. Et en plus, c’est l’Etat lui-même qui fait advenir de véritables lieux de non-droit, comme le sont ces « jungles » : elles surgissent de la tension entre une politique nationale hostile à l’immigration et l’état de fait des migrations. Les migrants qui sont parvenus sur le sol français sont bien souvent inexpulsables, au moins provisoirement, et l’Etat est conduit à tolérer leur présence. Le fait que cette tolérance ne s’accompagne ni d’une véritable politique d’accueil ni d’un cadre juridique conduit à créer des marges extralégales de la République.
Exclus du cadre républicain, les migrants ne peuvent donc avoir accès aux structures civiques de l’Etat. Ils n’existent pas en tant que sujets politiques et juridiques.
CP : Vous avancez une idée très séduisante pour tenter de remédier aux conditions de vie et traitements imposés aux migrants, qui est celle de “zones franches”. Pouvez-vous nous préciser cette notion ?
S. Djigo : Il s’agit plutôt de « lieux de franchise » pour reprendre l’expression qui désignait, au Moyen-Age, des endroits, institutions, quartiers ou villes bénéficiant d’une certaine autonomie par rapport au pouvoir central. Dans notre contexte contemporain, l’idée de ces lieux de franchise est issue de la tension, accrue par le processus administratif de décentralisation, entre les politiques de l’Etat et les politiques territoriales. Une franchise consisterait, pour certaines municipalités, à avoir le droit de se soustraire en partie à la souveraineté nationale en pratiquant des politiques locales autonomes. C’est ainsi que le quartier du Faubourg Saint- Antoine à Paris autorisait le travail des ouvriers qui n’avaient pas encore de maîtrise, ou que les ambassades accueillaient des personnes ayant commis une infraction, devenues « hors-la-loi ». Ces lieux remettent en question les normes du droit national et la rigidité de la loi : il arrive que le respect d’une loi générale contredise la justice dans certains cas particuliers.
On peut ainsi se dire que le traitement des migrants, leur invisibilisation, la politique de dissuasion à leur égard est moralement discutable et que leur délit (avoir franchi illégalement la frontière) n’en fait pas des criminels. C’est d’ailleurs par humanité et pour des raisons morales que des maires de diverses obédiences politiques comme Damien Carême à Grande-Synthe (EELV) ou Jean-Pierre Bataille à Steenvoorde (LR) justifient leur accueil des migrants sur des terrains communaux. Envisager des lieux de franchise ne ferait que reconnaître et donner une légitimité à une situation qui existe déjà dans les pratiques et éviterait la contradiction et la lutte permanente entre autorités municipales et autorités préfectorales. Ce n’est donc pas une proposition utopique ni une suggestion coûteuse.
On m’objecte parfois que cela est irréalisable au regard du droit ou de la réalité économique. Mais en réalité, on le fait déjà : d’abord, je remarque que la République a su faire preuve d’une très grande créativité en matière de droit de séjour des migrants, lorsqu’on est allé chercher des travailleurs maghrébins dans les années soixante pour les installer dans des bidonvilles et des cités de transit à proximité des chantiers. L’Etat n’a alors eu aucun mal à concevoir des titres de séjour provisoires. L’idée était bien de créer un statut juridique afin de fournir une main d’œuvre éphémère, totalement contrôlable, que l’on pourrait faire venir au gré des besoins des entreprises tout en les dissuadant de rester – dissuasion fondée en grande partie sur le logement. Difficile en effet de faire venir sa famille pour vivre dans un bidonville ou d’avoir le désir de s’y installer. Pourquoi ne peut-on faire preuve de la même créativité, cette fois-ci en faveur des migrants en transit ?
Il ne faut pas oublier que si ces milliers de personnes sont bloqués à la frontière, c’est à cause de l’échec et des contradictions internes en matière de sécurisation des frontières de l’Union Européenne. Tant que la France et l’Angleterre n’auront pas clarifié les termes de leur accord remis en question, semble-t-il, par le Brexit, les migrants tenteront le passage. On pourrait ajouter qu’il est certainement illusoire de vouloir à ce point contrôler les flux migratoires et que des individus qui fuient les conflits que l’on connaît en Syrie, au Soudan, en Irak, qui n’ont littéralement plus rien à perdre, continueront leur périple à destination de l’Angleterre au péril de leur vie. Si donc la politique nationale de sécurisation des frontières échoue, que fait-on « en attendant » avec ces milliers de personnes qui sont de facto sur le sol français ? Il faut bien imaginer des solutions, même provisoires.
Sur le plan économique, la « jungle » de Calais a fait la preuve de sa viabilité en tant que micro-société avec son marché, sa clientèle et ses entreprises. Au point d’ailleurs que certains discours fascisants expriment leur indignation que ces commerces illégaux ne payent pas de taxes…Là encore, nous sommes capables d’être souples et inventifs en matière de législation économique, comme le montrent les zones franches, qui reposent sur le principe de l’exonération de certaines taxes. On pourrait parfaitement imaginer qu’un espace comme celui de la « jungle » de Calais, désormais entièrement détruite, eut pu donner lieu à une telle « franchise » juridique et économique, donnant à ses habitants la possibilité de sortir de l’illégalité, d’être protégés par un statut, de sortir du campement sans y être confinés, de travailler et de construire pour chacun une solution individualisée à moyen terme. Ce que ne font pas les CAO, qui relèvent d’un contrôle des populations et qui n’ont d’autre vocation que de confiner les migrants et de les conduire face à l’alternative tranchée : demander l’asile qu’ils ont 80 % de probabilité de se voir refuser ou retourner dans le pays qu’ils ont quitté parce qu’il était devenu invivable.
CP : Vous abordez aussi la question des droits des migrants à s’organiser, désigner leurs représentants, exercer des droits politiques. Quel est l’enjeu de cette prise directe de parole ?
S. Djigo : Ce qui me frappe dans la façon dont les gouvernements français successifs traitent la question des migrants depuis 20 ans, quelle que soit leur couleur politique, c’est une constante : la négation et le mépris total pour les principaux intéressés. On a le sentiment d’une gestion de matériel : on déplace des objets, on les stocke dans des espaces disponibles, etc..Mais jamais on ne leur demande « pourquoi Calais ? ». J’imagine que nos gouvernants ont du mal à entendre cette vérité : que la France a grandement perdu son attractivité en tant que terre d’asile et qu’elle est devenue relativement indésirable sur l’échelle des pays d’accueil européens. Il y a des raisons objectives à ce manque d’inclination pour la France : les violences policières qui sont le corollaire de notre politique de dissuasion vis-à-vis des clandestins, les délais de traitement des demandes d’asile, les difficultés du regroupement familial, le chômage, la barrière linguistique, le racisme et l’islamophobie. Comme me le disait un jeune migrant pakistanais diplômé en électronique : « Si je reste en France, je vais finir au mieux vendeur de kebabs ». On est loin du rêve français, de la patrie des droits de l’homme, etc..
Il faut comprendre ce manque de goût pour la France, qui résulte de notre frilosité à accueillir les étrangers, de notre opposition au multiculturalisme. Une politique qui n’intègre pas les intérêts des premiers intéressés est vouée à l’échec et au-delà, elle interroge sur ce que l’on entend par « démocratie ». Il est clair que pour exister dans l’espace public démocratique, il faut être citoyen et/ou représenté. Mais qui représente les intérêts des migrants en transit. ? Personne. Pour paraphraser le titre d’un excellent article de l’intellectuelle indienne Gayatry Chakravorty Spivak, demandons-nous : « les migrants peuvent-ils parler » ? Pour parler, il faut être reconnu en tant que sujet, avoir accès aux structures de l’Etat, sinon, personne ne vous écoute ; vous n’avez pas de parole publique. Quand, pour se faire entendre, des migrants iraniens en viennent à se coudre la bouche (en mars dernier), on comprend que cette absence de représentation anéantit la possibilité d’avoir des droits politiques et même, de revendiquer ses simples droits humains.
Il y a eu une récente tentative des migrants pour s’organiser en communauté politique et se doter de représentants : le Parlement des migrants, qui s’est tenu en février 2016 à Hambourg sous l’impulsion d’une association, « Les Lampedusa à Hambourg ». Il y a aussi de très dynamiques associations de sans-papiers en France. Mais on est encore loin d’une véritable représentation politique, celle-ci restant conditionnée par la citoyenneté nationale.
CP : Vous relevez la contradiction que doivent gérer les diverses associations de solidarité, qui de fait suppléent en partie aux manquements de l’État et des ses institutions. Cette contradiction peut-elle être surmontée ?
S. Djigo : L’Etat soutient une politique de fermeture des frontières et lutte contre l’immigration clandestine. Cette position se prolonge par des dispositifs de dissuasion : non-accueil, absence de logements, violences policières. Tout est fait pour que les migrants n’aient aucun désir de s’installer ici, de demander l’asile en France et pour dissuader les éventuels candidats à la migration de venir chez nous. Et pourtant, ces migrants arrivent jusqu’à Calais. On ne peut comprendre cela si on n’a pas à l’esprit les atrocités qu’ils fuient, qui sont la guerre, l’oppression et la misère. Ils sont donc sur le territoire de la République, face à un Etat qui nie leur présence et refuse donc toute forme d’accueil. Il n’y a pas de politique publique d’accueil et ce sont les associations de bénévoles ou humanitaires qui pallient cette absence. Sauf que ce n’est pas à elles de le faire, dans la mesure où l’accueil n’est pas une question éthique mais politique.
Nous sommes victimes d’une conception erronée de l’accueil, que nous envisageons en termes d’hospitalité. L’hospitalité est une vertu morale et une pratique privée. Concevoir l’accueil des migrants comme une question d’hospitalité (ou de manque d’hospitalité) revient à dépolitiser le problème. On fait comme si l’Etat était un super-particulier offrant ou non son hospitalité dans la maison-France. C’est une métaphore source de confusions. L’Etat n’a pas être hospitalier ou inhospitalier, mais à engager une politique d’accueil en cohérence avec les principes du droit, comme la Convention de Genève, dont il est signataire. Et s’il ne le fait pas, alors que les municipalités « franchisées » puissent le faire.
CP : Pour en venir à la société française et à ses supposés représentants politiques, quels enseignements peut-on tirer de leurs réactions (ou de leur absence de réaction) ?
S. Djigo : Il y a une incontestable continuité entre le gouvernement actuel et les précédents. Nicolas Sarkozy prétendait régler la question en fermant Sangatte, donc en interdisant l’accueil pour invisibiliser les migrants. Eric Besson rappelait en 2009, par cette si élégante formule : « Ici, c’est Calais, pas Kaboul », et ce faisant, il faisait comme si c’était les migrants eux-mêmes, et non l’Etat français, qui étaient responsables du surgissement d’enclaves hors-la-loi. La destruction brutale des « jungles » dans les semaines qui précédent s’inscrit dans cette politique d’invisibilisation : comme si le démantèlement des campements allait conduire à l’évaporation de leurs occupants, comme si les migrants allaient miraculeusement désirer retourner dans les Etats qu’ils ont fui, demander l’asile en France et perdre leur goût pour l’Angleterre. Il y a, dans cette façon de se positionner, à la fois un terrible cynisme et les traces d’une pensée magique tout à fait archaïque.
Rappelons aussi que ce qui avait mis un terme à la grève de la faim des migrants iraniens de Calais en mars dernier, c’était la promesse faite par les autorités préfectorales et municipales, de ne pas détruire ce qui restait du campement de Calais, d’en améliorer les conditions de vie, avec une route goudronnée, des logements en dur, des sanitaires. Que vaut une promesse faite à des migrants clandestins ? Sans doute la même chose qu’une promesse électorale.
CP : A-ton selon vous franchi un seuil, où les politiques bellicistes et interventionnistes occidentales à l’étranger entraînent un coût humain qui n’est plus seulement l’objet de statistiques mais aussi de flux migratoires impactant directement nos sociétés ?
S. Djigo : Il faut effectivement s’interroger sur l’importance de ces flux. Depuis les années 2000, ce sont en gros entre 200 et 500 personnes qui transitent via Calais afin de passer en Angleterre. Depuis 2014, nous sommes passés à un comptage mensuel de ces migrants, jusqu’à atteindre plusieurs milliers en 2016. Cela s’explique d’une part par la fermeture de la frontière franco-britannique : les centaines de personnes qui passaient s’entassent désormais à Calais. D’autre part, nous vivons effectivement dans une époque où le nombre et l’intensité des conflits et des violences est particulièrement élevé. On ne doit pas se focaliser uniquement sur Calais ou sur la France : combien de migrants vivent réfugiés sur le continent africain ou en Turquie ? C’est un phénomène global et étendu.
Le petit nombre de ceux qui ont la force, le courage et les moyens financiers d’entreprendre le voyage en Europe arrivent ici. Et il est clair que s’ils souffrent de leur clandestinité, ils peuvent aussi avoir moins de scrupules à se réfugier dans des Etats qui sont impliqués dans la situation invivable de leur pays d’origine.
On peut comprendre que lorsque la France bombarde Raqqa, un migrant syrien se sente relativement légitime à venir chercher refuge en France.
Et puis il y a aussi le passé colonial, qui témoigne de l’implication ancienne des Etats occidentaux dans les politiques et les économies de nombreux pays en Afrique et en Orient. Faut-il s’étonner que des migrants Pakistanais désirent aller en Angleterre ou que les Syriens se souviennent de Picot et Sykes ?
Enfin, ce ne sont pas seulement les politiques bellicistes qui favorisent les migrations, mais aussi un certain impérialisme économique et le coût humain du capitalisme mondialisé. Il faut alors questionner notre tendance à moraliser la figure du migrant et à opérer, sur des critères moraux, un tri entre des « bons » et des « mauvais » migrants. Les bons, ce seraient ceux qui fuient les persécutions. Les mauvais, ceux qui fuient « seulement » la violence économique de la misère. De là à suspecter tout migrant de venir chercher profit en Europe, il n’y a qu’un pas, assez vite franchi.
CP : La criminalisation des migrants, que ce soit par la suspicion systématique, le vocabulaire employé à leur égard, les traitements infligés par les institutions, ne rappelle-t-elle pas les souffrances infligées (pour ne prendre que cet exemple) aux républicains espagnols fuyant le franquisme en 1939 ? N’y a-t-il pas “une tradition française” et une propension historique à confiner les migrants dans des camps, organisés ou non par les institutions ?
S. Djigo : Paradoxalement, la république française s’est bâtie sur la tradition de l’asile et de l’accueil des frères révolutionnaires luttant pour la cause commune de la liberté. L’exemple des camps où ont été parqués les Républicains espagnols nous rappelle en effet que la politique de gestion et de contrôle des populations n’est pas une nouveauté. La grande différence, c’est que les Républicains ont été placés dans des camps véritablement concentrationnaires, administrés par l’Etat, avec la présence de l’armée, parfois même des soldats issus des colonies. Il y avait un écart politique entre le gouvernement d’alors et l’idéologie des Républicains espagnols.
Aujourd’hui, on oscille entre tolérance, dissuasion et dispersion (la dispersion étant le prélude à l’expulsion). Les camps sont auto-gérés, auto-installés, relativement libres. Ce qui est intéressant, c’est de voir que le critère discriminant qui motive le non-accueil n’est pas, au fond, un critère racial, national ni même religieux. Nous n’avons pas su accueillir nos propres voisins espagnols. On comprend mieux cette tradition de frilosité envers les migrants si l’on se reporte au paradigme proposé par le sociologue Norbert Elias, qui oppose les insiders (les établis) et les outsiders (les nouveaux venus). Le migrant est une menace, un concurrent pour les établis : s’il parvient à s’établir aussi, alors, il faudra partager avec lui les fruits de l’appropriation.
CP : A la lecture de votre ouvrage, il apparaît que pour les migrants arrivant sur le sol français, des solutions existent pour un traitement décent et respectueux du droit de la personne. Mais comment les défendre ? Et au plus tôt les imposer ?
S. Djigo : A mon avis, la solution passe par le rôle des maires. Plusieurs maires sont volontaires pour accueillir des migrants en transit et pour leur fournir des conditions d’accueil dignes. Ils sont épuisés par les heurts avec l’Etat (le préfet). Une solution très simple et peu coûteuse serait de tout simplement légitimer leur action : officialiser ce qui est un état de fait. C’est ce qu’est parvenu à faire Damien Carême de manière très subtile à Grande-Synthe. Quand on voit le coût de la surveillance policière dans une ville comme Calais, on se dit qu’on pourrait transférer le même argent public sur les conditions du logement provisoire.
En outre, un droit de transit est tout à fait pensable puisque le droit français le fait déjà pour les étudiants ou les travailleurs. On devrait pouvoir transiter de manière inconditionnée pour une certaine durée, le temps d’élaborer une solution migratoire raisonnable, le temps aussi que les rapports franco-britanniques soient clarifiés. Le problème de l’asile, c’est qu’il est conditionné à des critères pas toujours transparents, comme la clause de la nation la plus favorisée. Quid de celui qui ne peut prouver les persécutions dont il a été victime ? Et ces conditions impliquent une certaine moralisation : on adresse aux migrants une exigence exorbitante, celle de la sainteté. Il faudrait qu’ils soient moralement purs pour recevoir l’asile. Si on appliquait à nos concitoyens français les mêmes critères, il ne resterait plus beaucoup de Français sur le territoire…
Une plus grande générosité en matière d’asile est aussi concevable : on dispose déjà des instruments juridiques. Mais là, on affronte les difficultés de l’asile : l’absence de droit au travail, la durée de traitement des demandes, les délais du regroupement familial…tout cela n’est pas très motivant pour les migrants.
Ce qui débloquerait la situation, c’est avant tout que nos gouvernants acceptent l’idée de prendre des mesures provisoires, de créer les outils pour gérer une situation inédite et éphémère. A-t-on envie d’investir dans du provisoire ? c’est toute la difficulté.
Novembre 2016 – Propos recueillis par Chronique de Palestine
